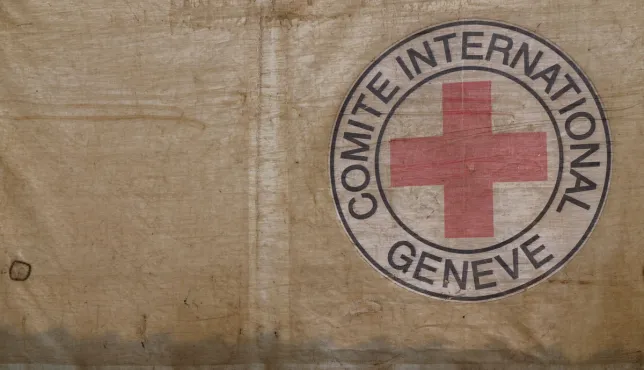TENSIONS AU PROCHE ET AU MOYEN-ORIENT: AGISSONS !
La situation au Proche et au Moyen-Orient continue de se dégrader, avec la récente escalade de la violence dans la région affectant d’innombrables personnes à Gaza, en Iran, au Liban, en Syrie, au Yémen et ailleurs. Les civils sont les plus durement touchés, et les besoins humanitaires ne cessent d’augmenter.
Le CICR s’emploie activement à en atténuer les conséquences. Nos équipes fournissent aux plus vulnérables des biens et services essentiels, tels que de la nourriture, de l’eau, des articles de première nécessité et des soins médicaux.
Grâce à vos dons, nous pourrons faire davantage pour sauver des vies, soutenir des structures médicales et acheminer des secours vitaux là où les besoins sont les plus pressants. Ensemble, nous pouvons faire la différence en œuvrant au service de l’humanité et de la dignité.